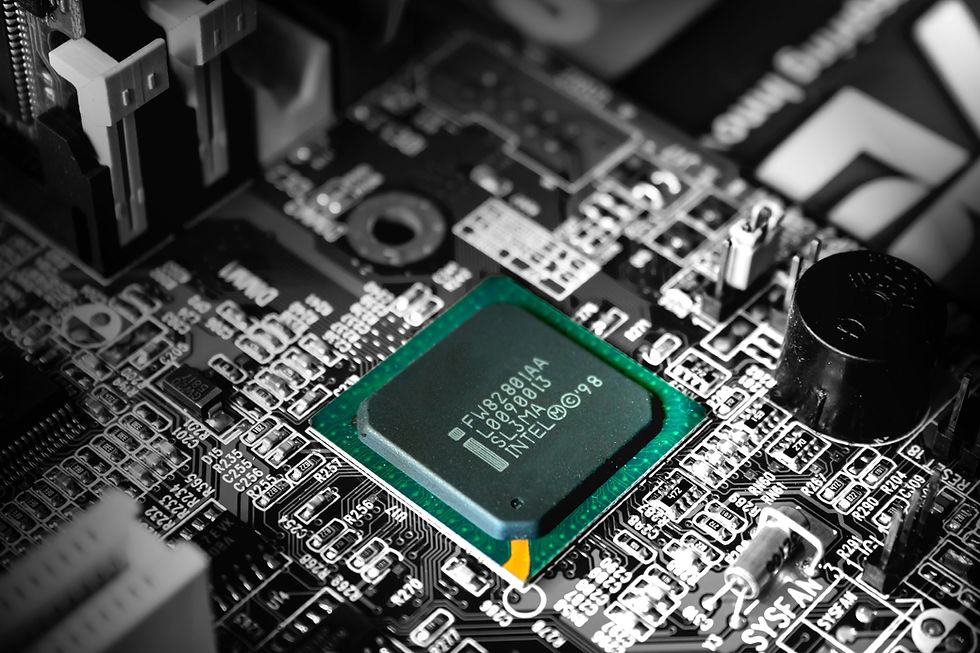SCIENCE, POPULISME ET NATIONALISME : QUELS LIENS, QUELLES CONSÉQUENCES ET QUEL AVENIR ?
- Observatoire Scientifique

- 10 mai 2025
- 3 min de lecture
Dernière mise à jour : 11 mai 2025
Notre époque est marquée par des crises systémiques d’ampleur mondiale: pandémie, dérèglement climatique, tensions géopolitiques, mutations technologiques rapides. Face à ces défis, la science apparaît comme un outil essentiel pour comprendre, anticiper et agir. Pourtant, dans de nombreux pays, la parole des scientifiques est de plus en plus contestée, ignorée, voire déformée.
Une science populiste au détriment de la recherche de la vérité
D'après le rapport du CEVIPOF intitulé Le populisme contre la science produit par Luc Rouban et Virginie Tournay, lorsque la science fait l'objet d’une remise en cause, ce phénomène serait “fortement liée à la montée en puissance du populisme.” Dans un article paru dans Le Nouvel Obs, l’épistémologue Camille Ferey observe la même chose : il existe une forte corrélation entre l'indice “populiste” et l’érosion de la confiance dans les institutions scientifiques. Les discours populistes rejettent souvent la complexité du réel, caricaturent la méthode scientifique, et cherchent des explications simples à des phénomènes complexes — quitte à verser dans le complotisme. D’autre part, ils n’hésitent pas à ignorer ou à déformer les faits lorsque ceux-ci ne correspondent pas à leurs discours. La recherche de la vérité, mise en valeur par les philosophes, est donc abandonnée pour séduire l’opinion publique.
Opposition systématique entre “le peuple authentique” et des “élites corrompues”
Le discours populiste dessine également un dualisme dans la société. D'un côté, il y aurait “le peuple authentique” et de l'autre des “élites corrompues” perçues comme déconnectées. Dans ce nouveau clivage devenu presque systématique, les scientifiques — chercheurs, médecins, climatologues, experts en santé publique, spécialistes des sciences humaines et sociales — sont souvent rangés du côté des élites, accusés de servir des intérêts étrangers ou idéologiques.
Ce soupçon s’est brutalement accentué pendant la crise du Covid-19. En Europe comme ailleurs, des figures populistes ont remis en cause les mesures sanitaires, les protocoles de vaccination ou encore la réalité même de la pandémie. Aux États-Unis par exemple, le président Donald Trump a publiquement contredit les experts du CDC (Centers for Disease Control) et vanté l’usage de traitements inefficaces.
Une montée de la défiance, alimentée par les discours populistes
Plus récemment, la Slovaquie a illustré de manière saisissante les tensions entre populisme politique et expertise scientifique. En avril 2024, le député Milan Mazurek, membre du parti politique slovaque d'extrême droite “Republika”, a défendu publiquement l'idée d'interdire certains vaccins utilisés pendant la pandémie, en s’appuyant sur les conclusions très contestées d’une commission parlementaire alignée sur les thèses complotistes. Les médecins slovaques, unanimes pour dénoncer cette démarche comme dangereuse et infondée, ont vu leurs recommandations ignorées au profit d’un discours visant à flatter la méfiance populaire. Cet épisode, largement discuté dans les médias slovaques, témoigne d’un profond changement : la science devient un instrument de lutte idéologique.
Le nationalisme et la science : entre isolement, censure et instrumentalisation
À cette défiance s’ajoute, dans certains cas, une volonté nationaliste de repli. Elle s’accompagne souvent d’un isolement sur la scène internationale. Souvent, les liens avec les programmes de recherche européens ou mondiaux sont coupés. La circulation des savoirs est donc fortement limitée. Aujourd'hui, la science progresse par coopération et confrontation des idées, et la limiter à un cadre national, c’est l’appauvrir de manière significative.
Les tendances nationalistes se traduisent aussi par un affaiblissement des moyens accordés à la recherche et la mise sous tutelle politique des institutions scientifiques. Le gouvernement hongrois, par exemple, a retiré à l’Académie des sciences de Budapest son autonomie financière en 2019, afin de placer la recherche sous l’influence directe du pouvoir politique. Ces politiques visent à aligner les travaux scientifiques sur une vision dite “officielle” de l’histoire ou de la société. Le nationalisme n'est donc pas qu'une façon de penser la science, mais il a aussi des manifestations concrètes dans l'action des gouvernements.
Quel avenir pour la démocratie ?
Selon un article de l’AFOPTIC, publié en avril 2025, il est urgent de réaffirmer le rôle de la science dans la démocratie. Pour cela, il faut notamment promouvoir la transparence : les institutions de recherche doivent communiquer clairement sur leurs méthodes et résultats. Enfin, la vulgarisation scientifique, en assurant que la connaissance soit accessible à tout le monde, serait elle aussi une façon de combattre la désinformation dans nos sociétés.